
Les États-Unis pressent le Canada de participer à la stabilisation en Haïti
Les États-Unis ont exhorté le Canada à s’impliquer davantage dans la stabilisation d’Haïti, confronté à une violence des gangs en pleine expansion, à une instabilité politique persistante et à une crise économique sévère, rapporte le journal canadien Global Mail, mardi 16 septembre 2025.
Lors d’une rencontre à Washington le 21 août, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a discuté en tête-à-tête avec la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, sur la situation haïtienne. Mme Anand a indiqué qu’il serait toutefois prématuré de parler d’un engagement militaire canadien sur le terrain. Elle se rendra prochainement à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies afin de poursuivre les discussions autour d’un plan de stabilisation pour Haïti.

Les États-Unis proposent la création d’une Force internationale de répression des gangs d’environ 5 500 membres, qui remplacerait la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) dirigée par le Kenya depuis 2024. Cette nouvelle force viserait notamment à renforcer les capacités de la police haïtienne et à superviser les opérations de sécurité avec l’appui logistique de l’ONU, incluant la surveillance par drones depuis un bureau installé à Port-au-Prince.
Le pays des Caraïbes est plongé dans une crise sécuritaire majeure : au cours des six premiers mois de 2025, plus de 3 000 personnes ont été tuées et plus d’un million de Haïtiens ont été déplacés par la violence des gangs, qui se sont procuré des armes sophistiquées, parfois introduites clandestinement depuis les États-Unis et d’autres pays de la région.
Des experts canadiens estiment que le Canada pourrait avoir peu de marge de manœuvre face à une demande directe de Washington, en raison des enjeux économiques et diplomatiques, notamment les négociations sur les tarifs douaniers. Selon Fen Hampson, professeur à l’Université Carleton, une force de 5 500 hommes ne suffirait probablement pas à stabiliser Haïti, et toute intervention internationale devrait être accompagnée d’un soutien économique significatif.
À l’inverse, Marylynn Steckley, également professeure à l’Université Carleton et spécialiste d’Haïti, met en garde contre un engagement militaire canadien. Elle estime que le Canada devrait plutôt concentrer son action sur l’aide directe à la population haïtienne, plutôt que de s’associer aux initiatives américaines qui, selon elle, ont souvent échoué et parfois servi des intérêts étrangers plutôt que les besoins des Haïtiens.
Depuis 2022, le Canada a déjà apporté plus de 400 millions de dollars d’aide internationale et de soutien sécuritaire à Haïti, dont 86 millions pour la MMAS, et fourni des drones pour aider la police locale à mieux surveiller les zones à risque. Alors que les discussions se poursuivent à l’ONU, le rôle du Canada dans la stabilisation d’Haïti reste donc à définir, entre pressions diplomatiques et questionnements sur l’efficacité et la pertinence d’un engagement militaire direct.














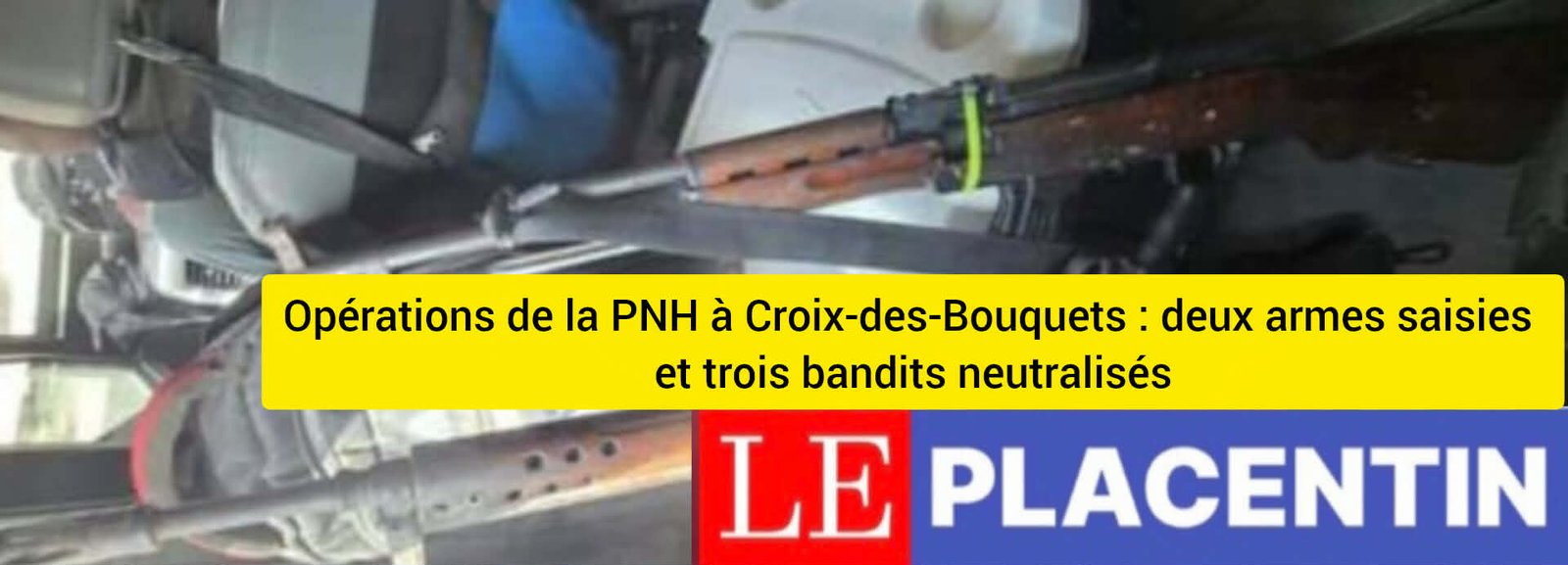



0 Commentaire